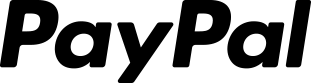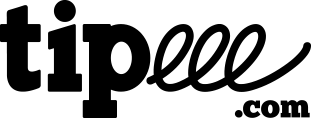Haute-Vienne : du pain bio qui ne dépend pas du cours du blé
La hausse des prix du blé ou les conflits géopolitiques n’ont aucun impact sur le prix du pain au levain bio produit par Claire et Gaël, autonomes en céréales qu’ils cultivent et transforment en farine dans leur ferme située près de Limoges. Nous avons voulu en savoir plus sur leur parcours, lequel pourra inspirer d’autres personnes qui voudraient s’installer.
Claire et Gaël, tous deux trentenaires, partageaient les mêmes rêves et se sont unis pour un même projet. Installés dans la Ferme des Sailles, au Vigen, à quinze minutes en voiture de Limoges, ils sont aujourd’hui paysans-boulangers et maraîchers bio. Même si les obstacles ont été nombreux, ils se sentent à leur juste place et rayonnent en proposant leur pain au levain cuit au four à bois, « moins cher qu’en boulangerie classique, et d’une qualité tout autre », élaboré à partir de farine fraîche moulue la veille. Nous avons pu nous entretenir avec Claire.
Nexus : Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans cette aventure ?
Claire : Chacun de son côté, avant même qu’on ne se rencontre, Gaël et moi avions envie de changer de métier. Les activités qu’on avait alors n’avaient pas vraiment de sens. Nous avions tous deux voyagé, puis décidé de nous initier à l’agriculture, en faisant des séjours dans plusieurs fermes où nous avons développé nos connaissances et notre expérience. Gaël en a fait plus de trente dans le monde entier.
Puis nous avons choisi de nous former de manière plus officielle en faisant le BPREA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole) et c’est sur notre lieu de formation que Gaël et moi nous sommes rencontrés. Lui était en formation de paysan-boulanger, et moi en maraîchage, et il était évident de nous installer et de commencer une activité agricole en commun.
Comment avez-vous atterri au Vigen, près de Limoges ?
Après le BPREA, nous avons travaillé dur pendant un an dans le domaine du tourisme de manière saisonnière pour voir si notre couple tenait, pour développer notre idée de projet et pour mettre de l’argent de côté.
Puis nous avons décidé de nous lancer et de trouver un lieu d’exploitation pour commencer notre activité agricole. Nous avons visité 20 fermes, et avons laissé plusieurs petites annonces, notamment sur le site de Terre de Liens, qui nous a contactés car ils avaient une ferme qui correspondait à nos critères. Nous sommes allés la visiter un soir d’hiver où il y avait du brouillard partout. C’était à la fois glauque et beau. On est tombés amoureux de l’endroit.
Il y avait tout sur place : de l’eau grâce à un forage, 30 hectares cultivables, un bâtiment pour construire le fournil, la meunerie et une maison à retaper. Le tout proche d’une grande ville, à 15 minutes en voiture de Limoges et à 4 heures de route de Nantes, d’où nous venons tous les deux.
Pouvez-vous nous raconter votre installation et comment vous avez fait financièrement ?
Après la visite, nous avons pris une location pendant un an pendant lequel nous avons monté notre dossier et travaillé chez des maraîchers pour continuer à apprendre le métier. Douze mois n’ont pas été de trop pour remplir tous les papiers nécessaires au lancement de notre activité. On aurait pu se faire accompagner par la Chambre d’agriculture, mais nous avons préféré tout faire nous-mêmes, avec l’appui de l’ADEAR Limousin.
Nous nous sommes installés il y a maintenant deux ans avec l’aide de l’association Terre de Liens, qui a acheté la grange et les terres pour un montant de 215 000 € et qui nous les loue actuellement. Nous n’en sommes donc pas propriétaires, mais avons négocié quelques travaux. En revanche, c’est nous qui avons investi grâce à notre épargne et des emprunts pour tous les travaux qui concernent notre activité. Terre de Liens rachète les terres agricoles et aide les agriculteurs qui n’ont pas les moyens d’investir seuls pour s’installer. Une fois achetées, les terres ne pourront être revendues et resteront toujours agricoles et en bio. Ce procédé évite la spéculation et les problèmes d’agrandissement.
Pour nous sentir chez nous, nous avons tout de même acheté la maison à retaper à côté de la grange avec une partie de nos économies et un crédit. À ce jour, nous vivons dans un mobile home en attendant la fin des travaux. Nous nous sommes engagés à la revendre uniquement à Terre de Liens ou à des agriculteurs bio qui voudraient reprendre l’exploitation si jamais un jour on voulait cesser notre activité. Cette association dispose de beaucoup de capacités financières grâce à de l’épargne citoyenne (dons ou actions).
La Safer à l’échelon local a vraiment été une alliée pour nous en stockant, achetant et revendant les terres à Terre de Liens.
Pour le matériel, nous avons préféré investir dans de la bonne qualité dès le départ, tel qu’un très bon four à bois, ce qui a nécessité des emprunts. On n’a pas choisi le « fur et à mesure », mais l’investissement de départ.
Pouvez-vous nous raconter un des obstacles rencontrés sur votre chemin ?
Cela faisait trois ans qu’il n’y avait personne à la ferme. Un silo, laissé par l’ancien exploitant, était rempli d’avoine pleine de charançons, le cauchemar de tout céréalier. C’est un parasite qui se trouve à l’intérieur de la plante et qui ne se voit pas. Il est très tenace et reste malgré le chaud ou le gel, il existe toujours un risque qu’il y en ait.
On a sorti toute l’avoine pour la brûler, mais l’avoine fume seulement, sans cramer. Il a fallu la benner dans un autre champ, faute d’une autre solution pour le moment.
C’est pourquoi nous nettoyons très régulièrement l’espace de tri et de stockage du blé et mettons notre blé en big bags sous vide d’air pour éviter qu’il soit contaminé.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le moulin que vous utilisez pour faire la farine de votre pain ?
Ce genre de petit moulin n’existait pas. Les frères Astrié l’ont mis au point pour que les paysans puissent produire leur propre farine, soit pour la vendre, soit pour l’utiliser. Celui que nous avons nous permet de produire 4 sacs de 25 kilos en une journée. On pourrait faire plus, mais pour le moment, nous préférons ne pas nous surcharger.
Le moulin tourne 12 heures pour produire la fournée du lendemain. Les nutriments de la farine sont bien là, car le blé n’est pas chauffé par le moulin, qui exerce une pression à froid avec une meule de granit. Notre farine est donc bien différente de celle des gros industriels dont les céréales ont été chauffées, vendue parfois plusieurs mois après leur production.
Le moulin ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est tout de même dans une pièce à part, la meunerie. Pour protéger des rongeurs et des parasites tels que les mites, il faut nettoyer cette pièce très régulièrement.
De quelle surface de culture disposez-vous pour cultiver le blé ? Quelle quantité de pain cela peut-il fournir au quotidien ?
Nous avons 40 hectares en tout, dont 30 hectares cultivables. Pour le pain, nous utilisons 8 hectares de blé par an, en rotation sur 30 hectares pour ne pas épuiser le sol. Nous laissons se recharger en azote le sol en laissant des prairies de trèfle. Nous faisons aussi une coupe de foin que nous donnons à nos voisins éleveurs. Cela permet de créer du lien avec eux.
Êtes-vous à 100% autonomes ?
Notre pain, de la semence à la vente, ne parcourt que 5 km et nous cultivons 40 variétés de blé différentes. Si une maladie touche un blé, tous les blés ne seront pas touchés. C’est du bon sens paysan. Nous réalisons également notre levain.
Mais ne nous leurrons pas, il y a plus alternatifs que nous. Les belles idées de l’autonomie totale sont actuellement difficilement concrétisables rapidement. Nous préférons la technique du pas-à-pas, pour ne pas nous épuiser et pour pouvoir vivre de notre activité. Même si nous n’en utilisons pas beaucoup, nous sommes dépendants du gasoil pour manœuvrer notre camion jusqu’au lieu de vente, notre motoculteur pour le maraîchage et notre tracteur pour les grandes cultures. Et puis, quand on y réfléchit, il y a du plastique partout. En ce qui nous concerne, beaucoup de notre matériel en contient.
De plus, nous recevons des aides de la PAC et avons fait des crédits à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d’euros, que ce soit pour aménager la grange ou pour rénover notre maison. Financièrement parlant, nous ne sommes donc pas totalement indépendants.
On n’est pas tellement prêts à lâcher tout ce qu’on a. Les semences pour le maraîchage, je les achète, car produire de bonnes semences, c’est un métier à part entière qui demande du temps et une tout autre organisation de travail. Le moulin que nous utilisons pour moudre notre farine est électrique, donc il consomme de l’énergie.
Si nous voulions être totalement résilients et ne dépendre d’aucune énergie ou matière externe comme le plastique, il faudrait apprendre à travailler encore plus différemment, comme Andrew Cocup, ce paysan-boulanger extraordinaire dans le Gers, ancien DJ à Londres, qui utilise la traction animale de ses percherons et des outils avec des batteries électriques, et qui s’est formé chez les amish. Notons qu’il utilise quand même de l’énergie et du plastique et qu’il a notamment un four électrique…
Sans tracteur, il nous faudrait beaucoup plus de mains ou des animaux dans les champs. Mais aussi que la nourriture produite soit vendue plus cher pour payer toute cette main-d’œuvre supplémentaire.
Y a-t-il une solidarité locale entre agriculteurs ?
Oui, tout à fait. Nous faisons partie d’une Cuma, une coopérative d’entraide entre agriculteurs, ce qui nous permet de partager du matériel comme un super-tracteur ou une charrue, que nous n’avons pas dû acheter nous-mêmes. De plus, nous troquons nos productions, par exemple du pain ou de la farine contre du fromage de chèvre et de la bière !
Quelles sont les difficultés auxquelles vous ne vous attendiez pas ?
On s’attendait à ce que ce soit difficile, mais pas à ce point. Physiquement, c’est parfois très dur, il faut être endurant. Remplir tous les papiers administratifs aussi. On travaille beaucoup. Nous avons eu très peu de temps de disponible au début. Tout mettre en place, tout créer (car il n’y avait rien) a été un travail énorme. Puis au quotidien, entre les grandes cultures, la meunerie, la boulangerie et la vente dans la foulée, la préparation du bois pour le four à bois, tous les petits bricolages permanents, l’entretien de la ferme au sens plus global (les arbres à couper, le broyage, etc.), mais aussi l’administratif, les papiers, la maison à retaper, l’accueil des wwoofeurs, et depuis cette année le maraîchage qui m’occupe à 95 %, on n’a pas le temps de s’ennuyer.
Avant, on avait beaucoup de liberté, on était très mobiles : on a dû renoncer à beaucoup de choses. Au départ, je me suis sentie enfermée dans ma ferme, mais cela m’a apporté d’autres joies. Si à un moment donné, j’ai pu percevoir cette immobilisation comme une prison, aujourd’hui, je la vois comme une libération : je n’avais jamais eu l’occasion de voir toutes les saisons défiler sur un même lieu de vie. Enfin, je suis à un endroit fixe et je peux m’engager dans un endroit. Pendant toute notre période de formation ou les saisons qu’on a faites, on se donnait sans rester, sans profiter du fruit de notre travail. On était là sans être là. Ici, on a créé des mares, on a planté des centaines d’arbres et on pense aux générations futures. On s’intègre pleinement, on s’ancre.
Qu’est-ce qui vous rend joyeux au quotidien ?
D’être tout le temps dehors, proches du vivant, proches de la nature. Voir que ça marche, que les gens sont réceptifs à notre projet. On se sent encouragés. On a enfin un sens à notre vie. On est souvent crevés, mais on est heureux. On peut mourir la conscience tranquille, en ayant le sentiment d’avoir fait notre part.
Nous sommes aussi très heureux de voir le nombre grandissant de personnes qui veulent s’installer, avec cette volonté de retourner à la terre. Pour nous, l’agriculture et l’alimentation sont des vecteurs de changements énormes.
Avez-vous eu et avez-vous toujours des partenariats avec la commune ou les collectivités locales ? Le Vigen vous a-t-il soutenus dès le départ pour ce projet ?
Localement parlant, la commune nous a autorisés à vendre dans le village deux fois par semaine. Nous n’avons pas reçu d’aide particulière de ce genre, hormis une prime départementale de 4 000 €, notamment car nous sommes en bio et en vente 100 % directe.
Arrivez-vous à vous dégager au moins un salaire ?
Pendant deux ans, on a touché le chômage suite à nos activités salariées. Depuis cette année, on se prend 1 000 € par mois à deux, mais le reste des bénéfices, on a décidé de le laisser dans la ferme pour avoir de la trésorerie. Dans un an, on espère avoir 2 000 € pour deux, et dans deux ans, 3 000 €. Mais concrètement, on n’a pas besoin de beaucoup d’argent pour vivre. La plus grosse charge qu’on ait est le crédit de notre maison qui s’élève à 600 € par mois. On échange beaucoup de nourriture avec les voisins contre du pain, et beaucoup de frais passent en professionnel dans le cadre de notre GAEC.
Nous avons pu embaucher une personne pour nous aider 20 heures par semaine pour le pain et les biscuits.
Les aides PAC, on en touche parce qu’on a 30 hectares. Cela nous permet d’avoir une matière première gratuite. Mais à terme, progressivement, on aimerait pouvoir les redonner à une association protectrice de l’environnement quand on n’en aura plus besoin. Ou pour réinvestir dans la ferme dans des projets pour la biodiversité, le social, ou pour développer de nouvelles techniques agricoles !
Combien d’habitants vivent au Vigen ? Avez-vous la capacité de fournir du pain à tout le monde ? Si la réponse est non, combien de boulangeries et quelle surface agricole faudrait-il pour approvisionner tout le village ?
Il y a environ 2 000 habitants au Vigen. Après l’autorisation d’exploiter, nous avons passé une année à nous installer, à faire les travaux, à débroussailler les terrains. Nous avons commencé la production la deuxième année et avions prévu des ventes plutôt faibles : 50 kilos de pain par semaine. Dès les deux premières semaines, nous avons atteint les 200 kilos hebdomadaires. Aujourd’hui, même si on pourrait en produire 350 kilos, nous en sommes à 250, ainsi qu’à 50 kilos de biscuits. La com que nous avons faite un peu partout a sans doute contribué au succès précoce de notre activité.
Si on part du principe qu’un habitant mange en moyenne environ 58 kilos de pain par an, notre production annuelle de 13 000 kilos permet d’en fournir à 224 personnes. Il faudrait donc 9 paysans-boulangers comme nous dans la commune pour approvisionner tout le monde et 270 hectares. Si on relocalisait la production de pain, cela créerait de l’emploi, un dynamisme économique, plus de liens entre les gens, et surtout plus de résilience face aux enjeux mondiaux.
Vous proposez du WWOOFING dans votre ferme. De quoi s’agit-il ?
Le wwoofing permet à des personnes désireuses de découvrir notre activité pour éventuellement lancer la leur ensuite de faire un séjour à la ferme. En échange de 5 heures de disponibilité par jour, nous leur offrons le gîte et le couvert. Ça n’est ni du salariat ni un stage. Cela nous permet à la fois d’être aidés et de transmettre notre savoir. Certains wwoofeurs ont parfois des compétences et des idées que nous n’avons pas, et on se permet mutuellement de progresser.
Pour éviter de répéter tout le temps les mêmes choses et écarter les personnes volatiles, nous ne proposons qu’à deux personnes par mois des sessions de wwoofing d’un mois complet.
Pour le moment, cela fonctionne très bien ici, car d’avril à octobre, il est prévu que nous ayons du monde tout le temps et nous sommes complets jusqu’en juillet. Jusqu’à présent, personne n’est parti avant la fin, même si on sent que certains ne s’installeront pas ensuite.
Nous restons souvent en lien avec ceux qui s’installent par la suite, à qui il arrive de nous demander des conseils techniques.
Nous avons des petites cabanes indépendantes pour accueillir les wwoofeurs, afin qu’ils se sentent bien. Pour les repas, on les prépare chacun à notre tour. On cale notre emploi du temps dès le début de la semaine.
Pour préserver notre intimité, nous ne passons pas tous les repas avec les wwoofeurs, mais seulement le déjeuner. Le week-end, chacun peut faire ses activités de son côté.
Est-ce que cette expérience a solidifié vos liens ?
Oui. Ce qui a préservé notre relation, c’est qu’on voulait avoir chacun notre atelier pour se gérer individuellement. C’est Gaël qui a le dernier mot pour la partie paysanne-boulangerie, et moi pour le maraîchage. Il y a eu beaucoup de moments où on s’est pris la tête, des moments où on a voulu tout lâcher, mais aussi de beaux instants de joie. Tout ce qu’on a vécu, ça nous a rapprochés. On a évolué ensemble. Toutes les difficultés rencontrées m’ont permis de mieux me connaître et de me transformer : entre le début de cette aventure et maintenant, je me sens changée, je me sens plus forte, plus armée physiquement et mentalement.
Toutes les émotions à travers lesquelles nous sommes passés et notre évolution personnelle ne peuvent être réellement comprises par l’autre que si cet autre l’expérimente aussi. Il faut vraiment le vivre pour le croire !
À quelqu’un qui voudrait faire comme vous, quels conseils donneriez-vous pour leur faire économiser du temps et de l’énergie ?
D’avoir pas mal d’expériences avant de se lancer. Beaucoup n’ont pas assez les pieds sur terre. Une installation, c’est un parcours très difficile et la formation est hyper-importante. Si on veut réussir, ça ne s’improvise pas. Plus on se forme, moins on se trompe et moins on perd du temps.
Pouvez-vous nous citer des citations-clé ou des préceptes de vie qui résonnent en vous ?
La communauté des Amérindiens m’inspire beaucoup. Par exemple, un proverbe lakota qui dit que tout ce que tu fais, ne le fais pas pour toi, mais pour la 7e génération. On s’implique pour la biodiversité par exemple, pour laisser un monde beau pour nos enfants et leurs enfants. Que ce soit du point de vue du vivant ou de l’humain.
Plus concrètement, on bâtit cette ferme méthodiquement pour prendre plaisir au travail, et pour que demain ça tourne aussi pour nos successeurs.
Maintenant que l’activité pain fonctionne bien, Claire se concentre sur le maraîchage. C’est encore le début d’une nouvelle aventure. Depuis début mai, des légumes et paniers bio sont vendus à la Ferme de Sailles, lieu en constante évolution…
Propos recueillis par Estelle Brattesani
Toutes les photos sont tirées du site de la Ferme de Sailles
✰Magazine NEXUS : 112 pages, 100 % INDÉPENDANT et SANS PUB !✰
✰Magazine NEXUS : 112 pages, 100 % INDÉPENDANT et SANS PUB !✰
👉 CHER LECTEUR, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! En plus de son magazine papier, Nexus vous propose du contenu web 100% GRATUIT, et une info 100% LIBRE ! Pour rappel, Nexus ne bénéficie d’aucune subvention publique ou privée et vit grâce à ses lecteurs, abonnés, ou donateurs.
Pour nous soutenir, vous pouvez :
✅ Vous abonner au magazine Papier & Numérique
✅ Feuilleter tous nos numéros et les commander à l’unité
✅ Acheter notre numéro 137 de novembre-décembre 2021 en kiosque, ou en ligne
✅ Faire un don ponctuel ou régulier sur TIPEEE ou sur PAYPAL
![]() Gardons le contact, retrouvez-nous sur les autres réseaux sociaux : https://magazine.nexus.fr/les-reseaux/
Gardons le contact, retrouvez-nous sur les autres réseaux sociaux : https://magazine.nexus.fr/les-reseaux/
👉 Découvrez tout notre contenu web vidéo en accès libre sur notre chaîne Youtube
👉 Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter
👉 Et pour contourner la censure, rejoignez-nous sur VK et Odysee !
👉 Vous pouvez aussi FAIRE UN DON ponctuel ou régulier sur TIPEEE ou sur PAYPAL pour financer le contenu en ligne GRATUIT. C’est grâce à votre contribution que l’équipe web pourra continuer !
Soutenez NEXUS, faite un don
Numéro en relation
Commentaires
Vous pouvez aussi aimer
LES PLUS POPULAIRES
CATÉGORIES
- Histoire (0)
- Conscience (1)
- Énergie (14)
- Environnement (33)
- Géopolitique (6)
- Science (13)
- Santé (75)
- Société (44)
- Exologie (19)
- Analyse (11)
- Billet d'humeur (13)
- Quizz (0)
- 5G (1)
- Agroécologie (1)
- Astrologie (0)
- Autonomie alimentaire (19)
- Résilience (1)
- Conflit d’intérêts (0)
- Écriture (1)
- Éducation (3)
- En kiosque ! (8)
- Entretien (106)
- Extrait (0)
- Liberte (1)
- Manifestation (1)
- Médias libres (3)
- News (377)
- Pedocriminalite (3)
- Reportage (12)
- Technoscience (6)
- Témoignage (7)
- Traditions & spiritualité (1)
- Vaccin (153)
- Test (0)
- Chronique (4)
- Magazine (19)
- Politique (7)